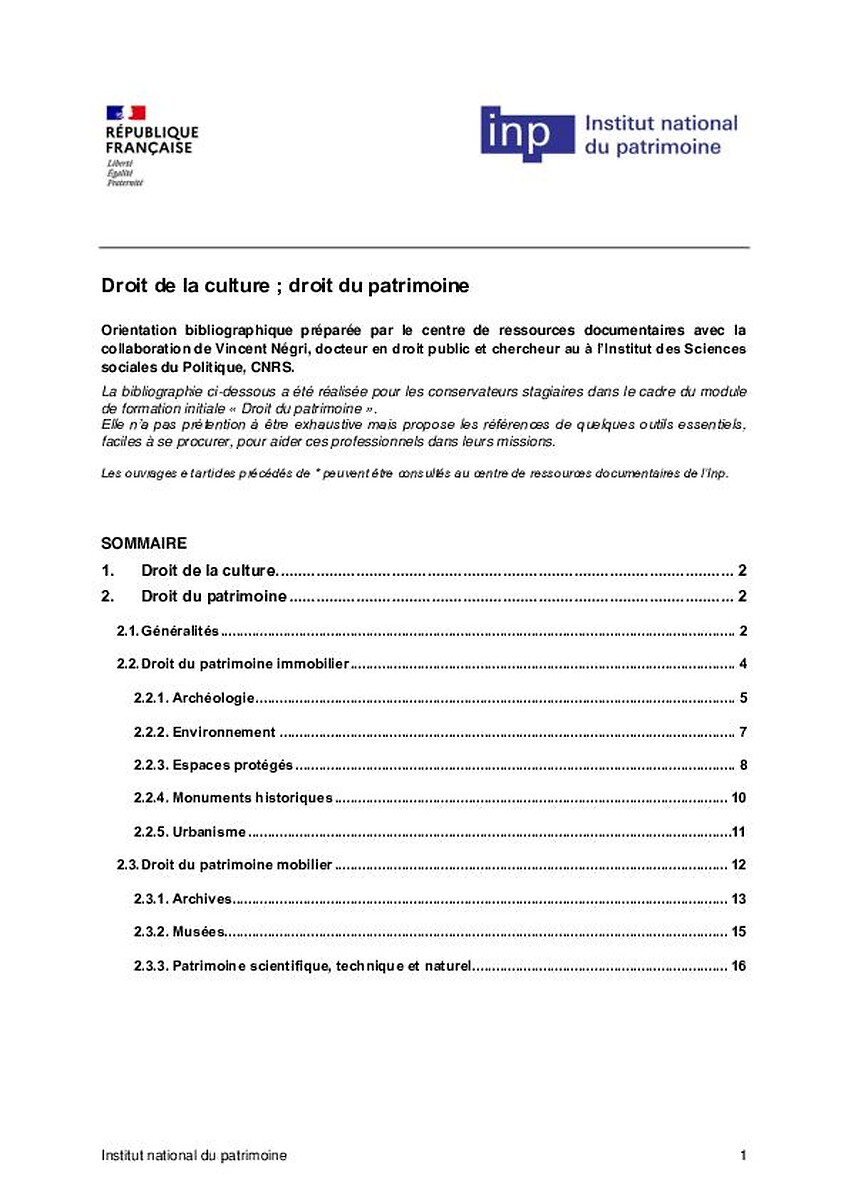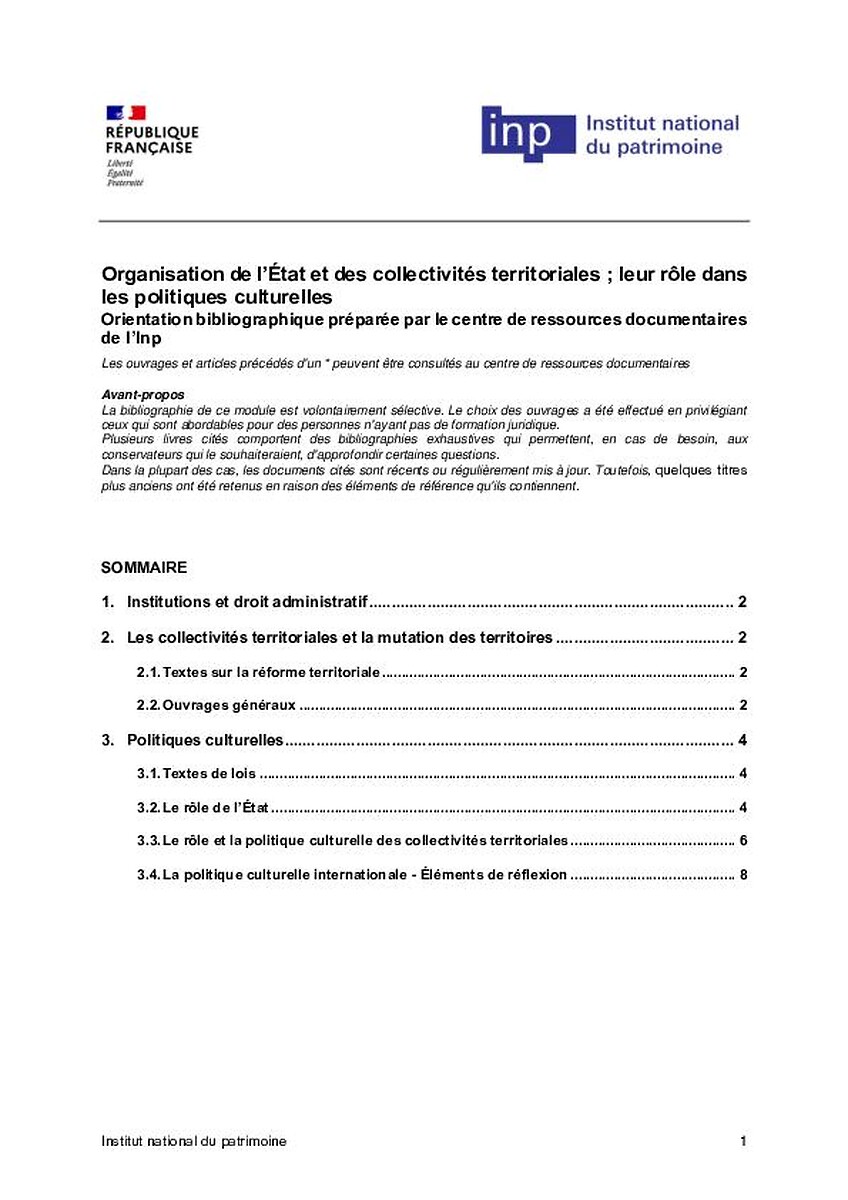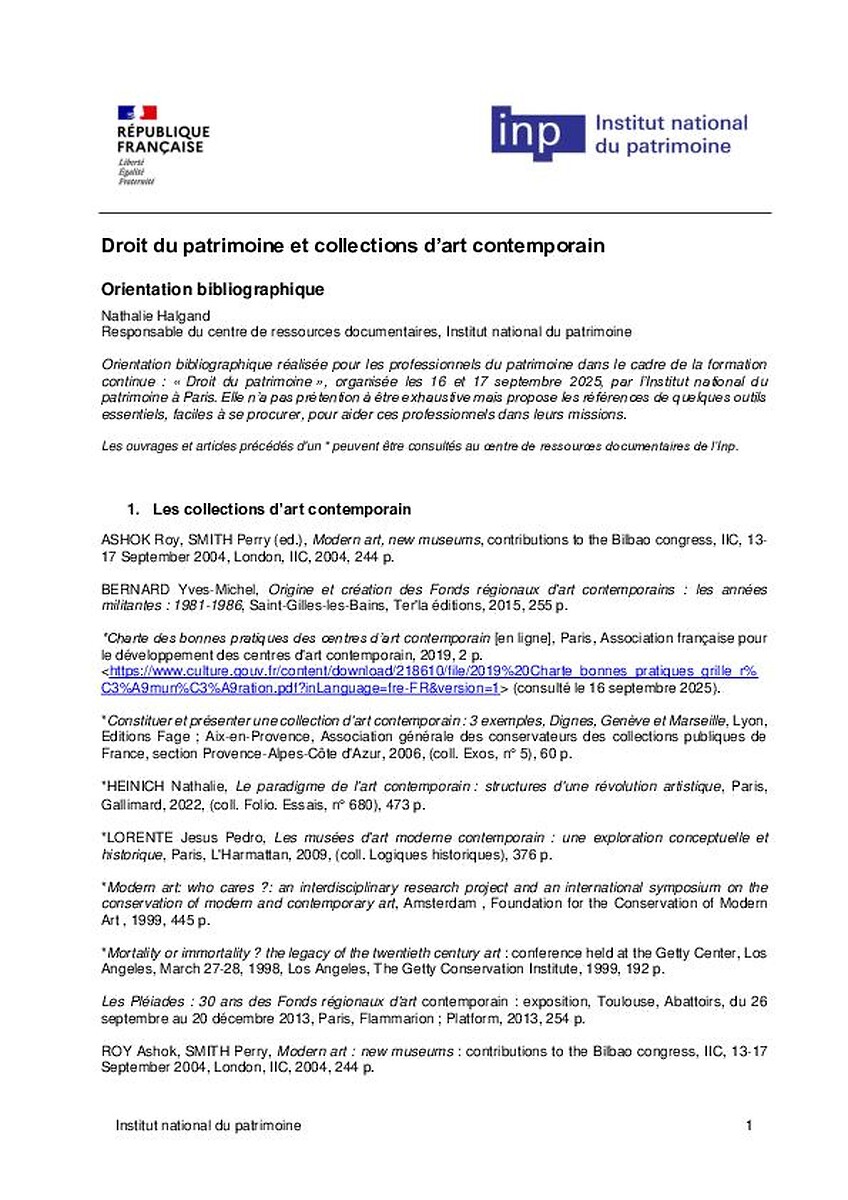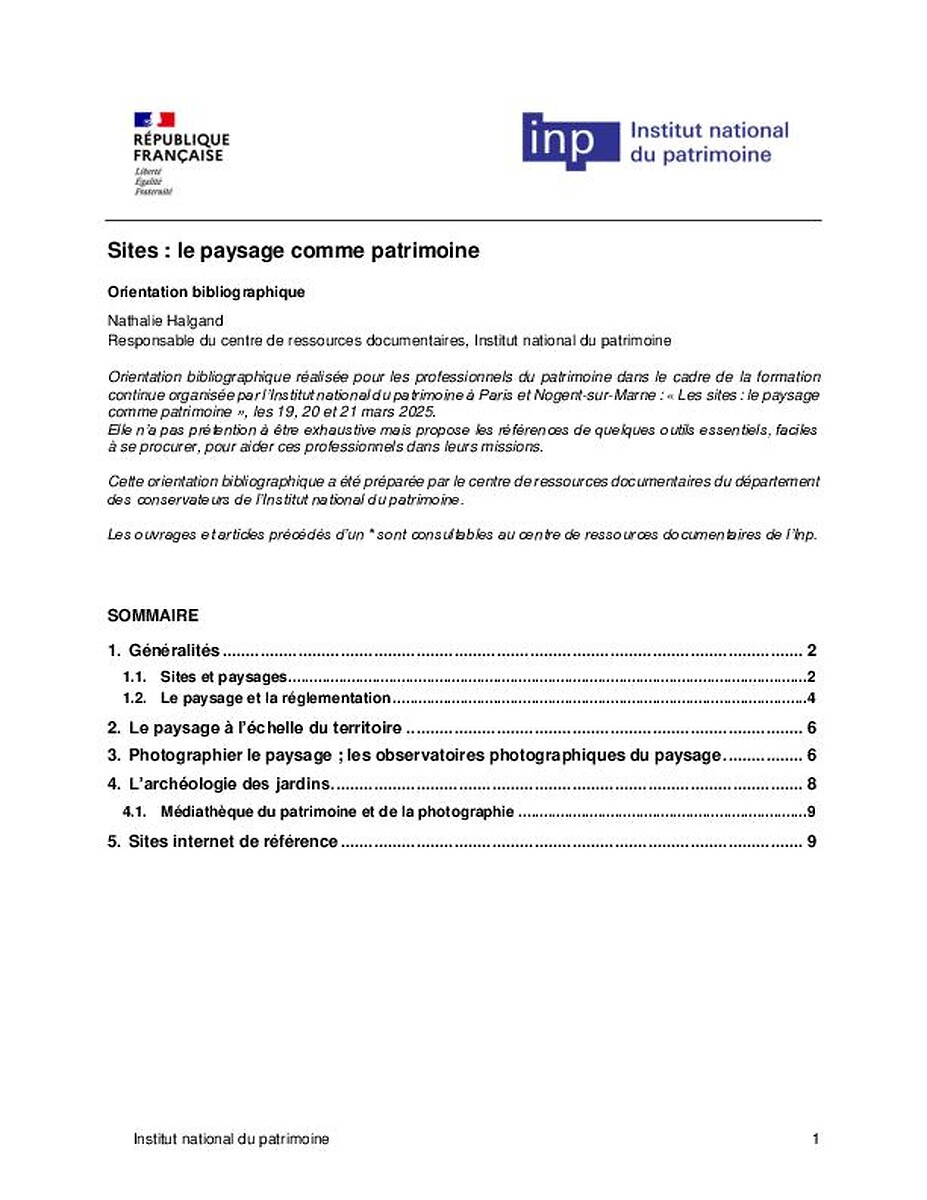La nature du patrimoine. Inventer de nouvelles formes de patrimonialisation
N° : 30092
video/mp4
- 1 679,2 Mo
- 1280x720
- sRGB
Description / Résumé
Interventions d'Aurélie Condevaux, maîtresse de conférences en anthropologie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, EIREST (Equipe interdisciplinaire de Recherche sur le Tourisme) ; Francesca
Cominelli, maîtresse de conférences, IREST-EIREST, Université Paris 1 PanthéonSorbonne et Vittorio Mainetti, professeur adjoint en droit international, Università degli Studi di Milano.
Discussions
Modération : Flore Heinrich, doctorante en droit public à l’Institut des sciences sociales du politique, ENS Paris-Saclay et Università degli Studi di Milano
Depuis la création de la première réserve artistique dans la forêt de Fontainebleau, par décret impérial en 1861, de nouvelles catégories juridiques ont émergé - qu’il s’agisse des sites, des réserves naturelles, des parcs naturels et des parcs nationaux, des paysages et des jardins remarquables – pour protéger des espaces naturels. La protection de ces espaces répond à des critères environnementaux de conservation des espèces végétales ou animales, ou à des motifs culturels liés à des qualités historiques, esthétiques, pittoresques.
La Convention du Conseil de l’Europe sur les valeurs du patrimoine pour la société, dite Convention de Faro, de même que le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, ont redéfini le rôle des sociétés et redistribué les responsabilités dans la mise en œuvre des politiques de préservation d’un patrimoine naturel, culturel et immatériel.
La préservation du patrimoine culturel concerne désormais les individus, les citoyens dans leur ensemble. Le droit au patrimoine culturel, que met en forme la Convention de Faro, substitue au principe de conservation un droit d’accès au patrimoine. Ce droit au patrimoine culturel s’arrime à un droit d’accès à la culture – dont les fondements figurent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans les Pactes de 1966 – et au principe de participation qui découle de la Convention d’Aarhus de 1998. Les groupes sociaux, autrement nommés “communautés patrimoniales” par la Convention de Faro, sont mis en capacité d’exercer de nouveaux droits et d’être associés aux prises de décisions relevant des politiques patrimoniales. La protection et la conservation d’un patrimoine n’est plus l’apanage des seuls experts. Pour protéger la nature, le droit de l’environnement et le droit du patrimoine culturel peuvent donc être mobilisés ; ce qui n’exclut pas qu’apparaissent des phénomènes de concurrence entre ces droits qu’il faut alors arbitrer.
Depuis la création de la première réserve artistique dans la forêt de Fontainebleau, par décret impérial en 1861, de nouvelles catégories juridiques ont émergé - qu’il s’agisse des sites, des réserves naturelles, des parcs naturels et des parcs nationaux, des paysages et des jardins remarquables – pour protéger des espaces naturels. La protection de ces espaces répond à des
critères environnementaux de conservation des espèces végétales ou animales, ou à des motifs culturels liés à des qualités historiques, esthétiques, pittoresques.
La Convention du Conseil de l’Europe sur les valeurs du patrimoine pour la société, dite Convention de Faro, de même que le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, ont redéfini le rôle des sociétés et redistribué les responsabilités dans la mise en œuvre des politiques de préservation d’un patrimoine naturel, culturel et immatériel.
La préservation du patrimoine culturel concerne désormais les individus, les citoyens dans leur ensemble. Le droit au patrimoine culturel, que met en forme la Convention de Faro, substitue au principe de conservation un droit d’accès au patrimoine. Ce droit au patrimoine culturel s’arrime à un droit d’accès à la culture – dont les fondements figurent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans les Pactes de 1966 – et au principe de participation qui découle de la Convention d’Aarhus de 1998. Les groupes sociaux, autrement nommés “communautés patrimoniales” par la Convention de Faro, sont mis en capacité d’exercer de nouveaux droits et d’être associés aux prises de décisions relevant des politiques patrimoniales. La protection et la conservation d’un patrimoine n’est plus l’apanage des seuls experts. Pour protéger la nature, le droit de l’environnement et le droit du patrimoine culturel peuvent donc être mobilisés ; ce qui n’exclut pas qu’apparaissent des phénomènes de concurrence entre ces droits qu’il faut alors arbitrer.
Le colloque "La nature du patrimoine. Inventer une relation de connivence entre nature et culture" s'est déroulé à l'Inp le 4 juin 2024.
Cominelli, maîtresse de conférences, IREST-EIREST, Université Paris 1 PanthéonSorbonne et Vittorio Mainetti, professeur adjoint en droit international, Università degli Studi di Milano.
Discussions
Modération : Flore Heinrich, doctorante en droit public à l’Institut des sciences sociales du politique, ENS Paris-Saclay et Università degli Studi di Milano
Depuis la création de la première réserve artistique dans la forêt de Fontainebleau, par décret impérial en 1861, de nouvelles catégories juridiques ont émergé - qu’il s’agisse des sites, des réserves naturelles, des parcs naturels et des parcs nationaux, des paysages et des jardins remarquables – pour protéger des espaces naturels. La protection de ces espaces répond à des critères environnementaux de conservation des espèces végétales ou animales, ou à des motifs culturels liés à des qualités historiques, esthétiques, pittoresques.
La Convention du Conseil de l’Europe sur les valeurs du patrimoine pour la société, dite Convention de Faro, de même que le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, ont redéfini le rôle des sociétés et redistribué les responsabilités dans la mise en œuvre des politiques de préservation d’un patrimoine naturel, culturel et immatériel.
La préservation du patrimoine culturel concerne désormais les individus, les citoyens dans leur ensemble. Le droit au patrimoine culturel, que met en forme la Convention de Faro, substitue au principe de conservation un droit d’accès au patrimoine. Ce droit au patrimoine culturel s’arrime à un droit d’accès à la culture – dont les fondements figurent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans les Pactes de 1966 – et au principe de participation qui découle de la Convention d’Aarhus de 1998. Les groupes sociaux, autrement nommés “communautés patrimoniales” par la Convention de Faro, sont mis en capacité d’exercer de nouveaux droits et d’être associés aux prises de décisions relevant des politiques patrimoniales. La protection et la conservation d’un patrimoine n’est plus l’apanage des seuls experts. Pour protéger la nature, le droit de l’environnement et le droit du patrimoine culturel peuvent donc être mobilisés ; ce qui n’exclut pas qu’apparaissent des phénomènes de concurrence entre ces droits qu’il faut alors arbitrer.
Depuis la création de la première réserve artistique dans la forêt de Fontainebleau, par décret impérial en 1861, de nouvelles catégories juridiques ont émergé - qu’il s’agisse des sites, des réserves naturelles, des parcs naturels et des parcs nationaux, des paysages et des jardins remarquables – pour protéger des espaces naturels. La protection de ces espaces répond à des
critères environnementaux de conservation des espèces végétales ou animales, ou à des motifs culturels liés à des qualités historiques, esthétiques, pittoresques.
La Convention du Conseil de l’Europe sur les valeurs du patrimoine pour la société, dite Convention de Faro, de même que le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, ont redéfini le rôle des sociétés et redistribué les responsabilités dans la mise en œuvre des politiques de préservation d’un patrimoine naturel, culturel et immatériel.
La préservation du patrimoine culturel concerne désormais les individus, les citoyens dans leur ensemble. Le droit au patrimoine culturel, que met en forme la Convention de Faro, substitue au principe de conservation un droit d’accès au patrimoine. Ce droit au patrimoine culturel s’arrime à un droit d’accès à la culture – dont les fondements figurent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans les Pactes de 1966 – et au principe de participation qui découle de la Convention d’Aarhus de 1998. Les groupes sociaux, autrement nommés “communautés patrimoniales” par la Convention de Faro, sont mis en capacité d’exercer de nouveaux droits et d’être associés aux prises de décisions relevant des politiques patrimoniales. La protection et la conservation d’un patrimoine n’est plus l’apanage des seuls experts. Pour protéger la nature, le droit de l’environnement et le droit du patrimoine culturel peuvent donc être mobilisés ; ce qui n’exclut pas qu’apparaissent des phénomènes de concurrence entre ces droits qu’il faut alors arbitrer.
Le colloque "La nature du patrimoine. Inventer une relation de connivence entre nature et culture" s'est déroulé à l'Inp le 4 juin 2024.
Auteur/artistes/intervenants
Direction scientifique ou pédagogique
Type de document
Institution(s) prêteuse(s) / Institution(s) partenaire(s)
Service producteur INP
Date de captation
Mots-clés
Citer la ressource
Cominelli, Francesca; Mainetti, Vittorio; Condevaux, Aurélie , "La nature du patrimoine. Inventer de nouvelles formes de patrimonialisation", Médiathèque numérique de l'Inp, 05 juin 2024 (consulté le 18 février 2026), https://mediatheque-numerique.inp.fr/rencontres-debats/colloque-inp/isp/nature-patrimoine-inventer-relation-connivence-entre-nature-culture/nature-patrimoine-inventer-nouvelles-formes-patrimonialisation
Type de licence
Tous droits réservés
Conditions d'utilisation
Cette ressource constitue une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, dont les producteurs sont titulaires. Aucune exploitation commerciale, reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, traduction, commercialisation, partielle ou intégrale des éléments de cette ressource ne pourra en être faite sans l’accord préalable et écrit des ayants droit, à l’exception de l’utilisation pour un usage privé sous réserve des dispositions différentes voire plus restrictives du Code de la propriété intellectuelle.