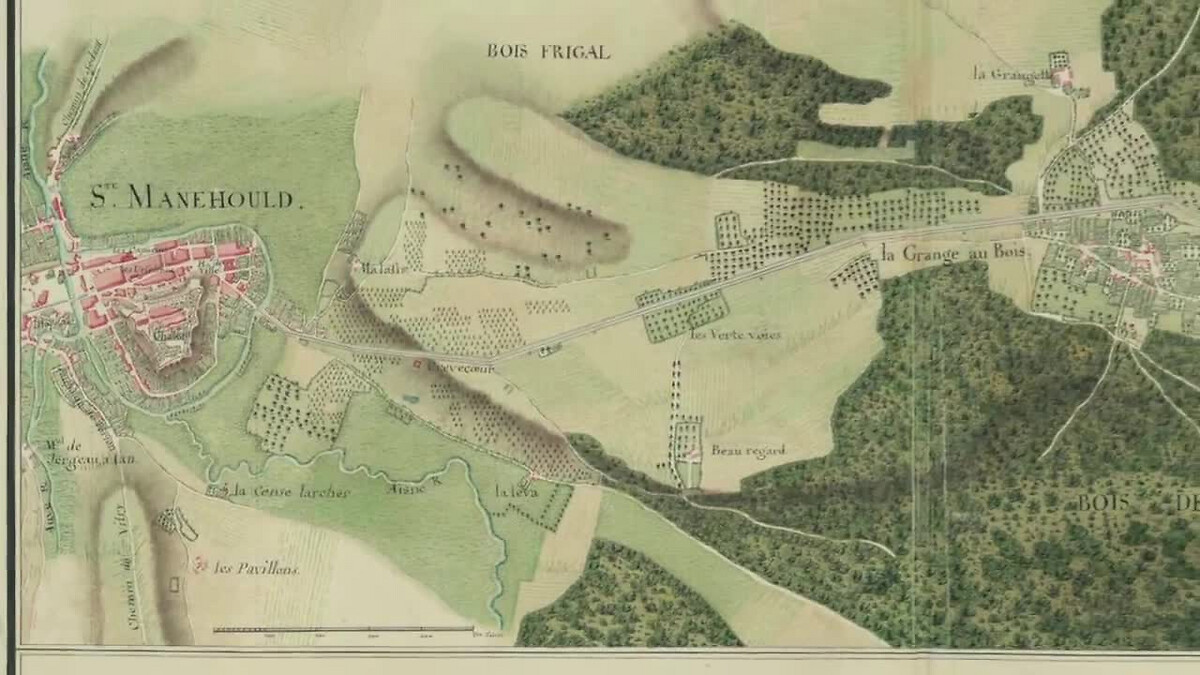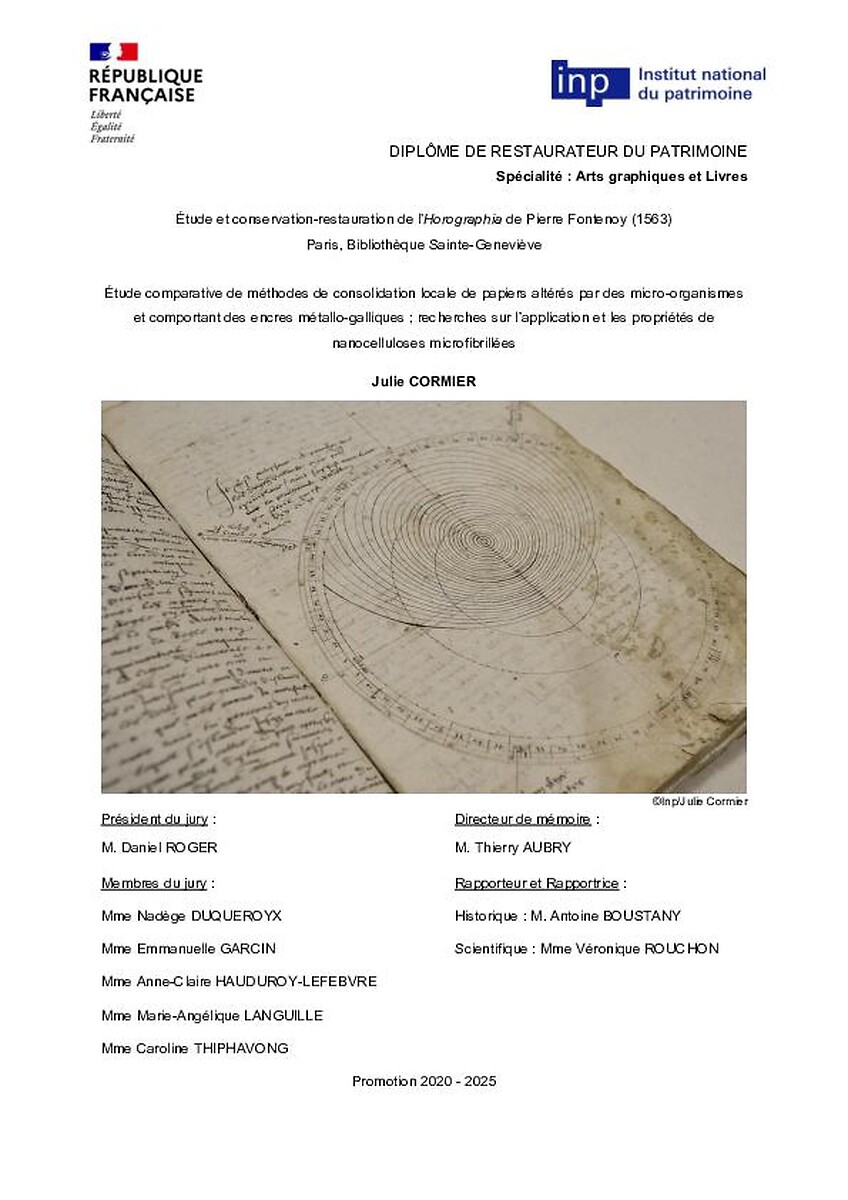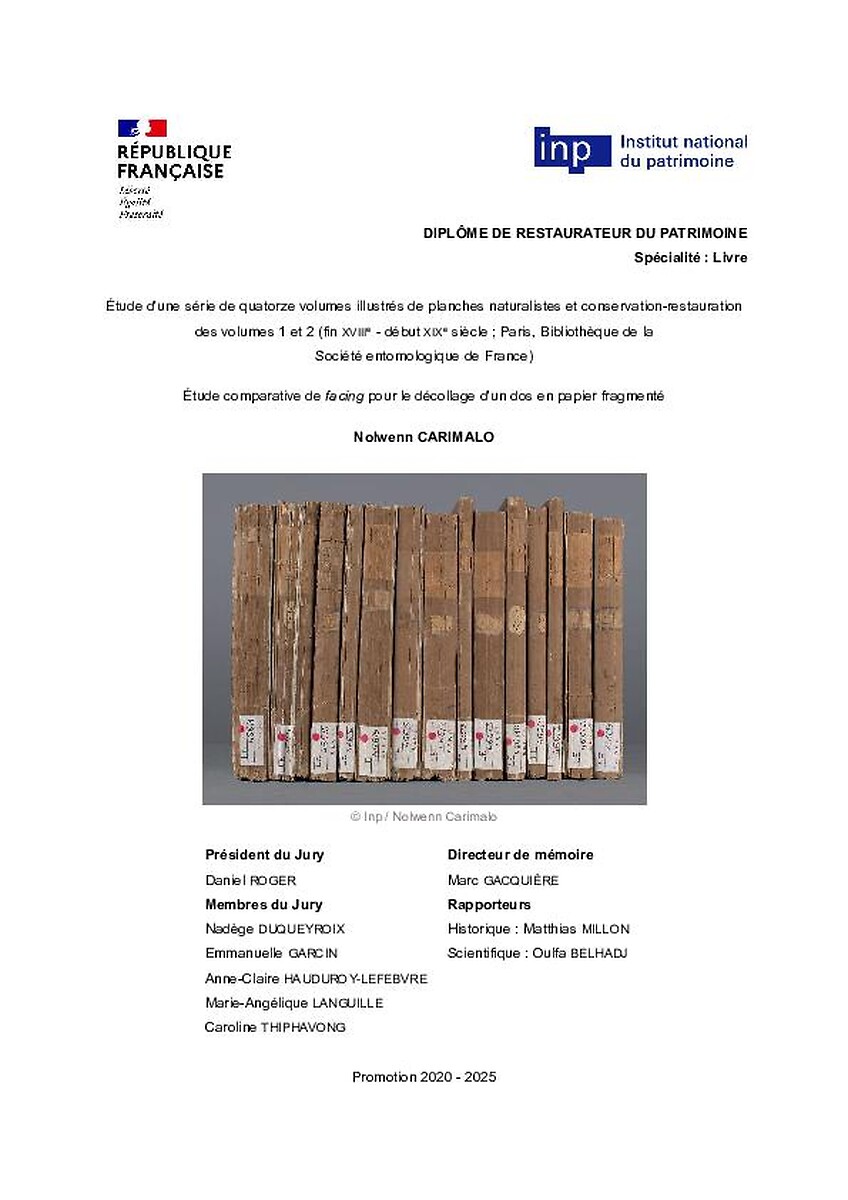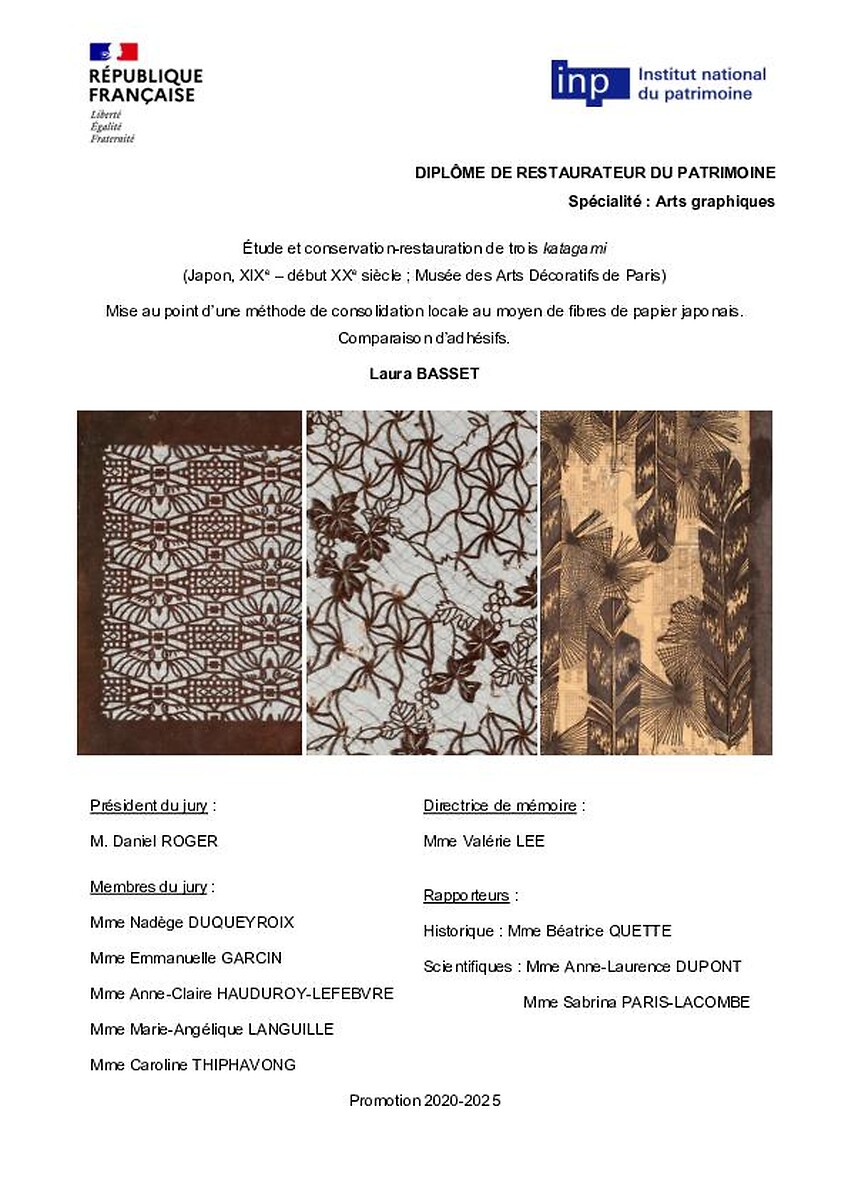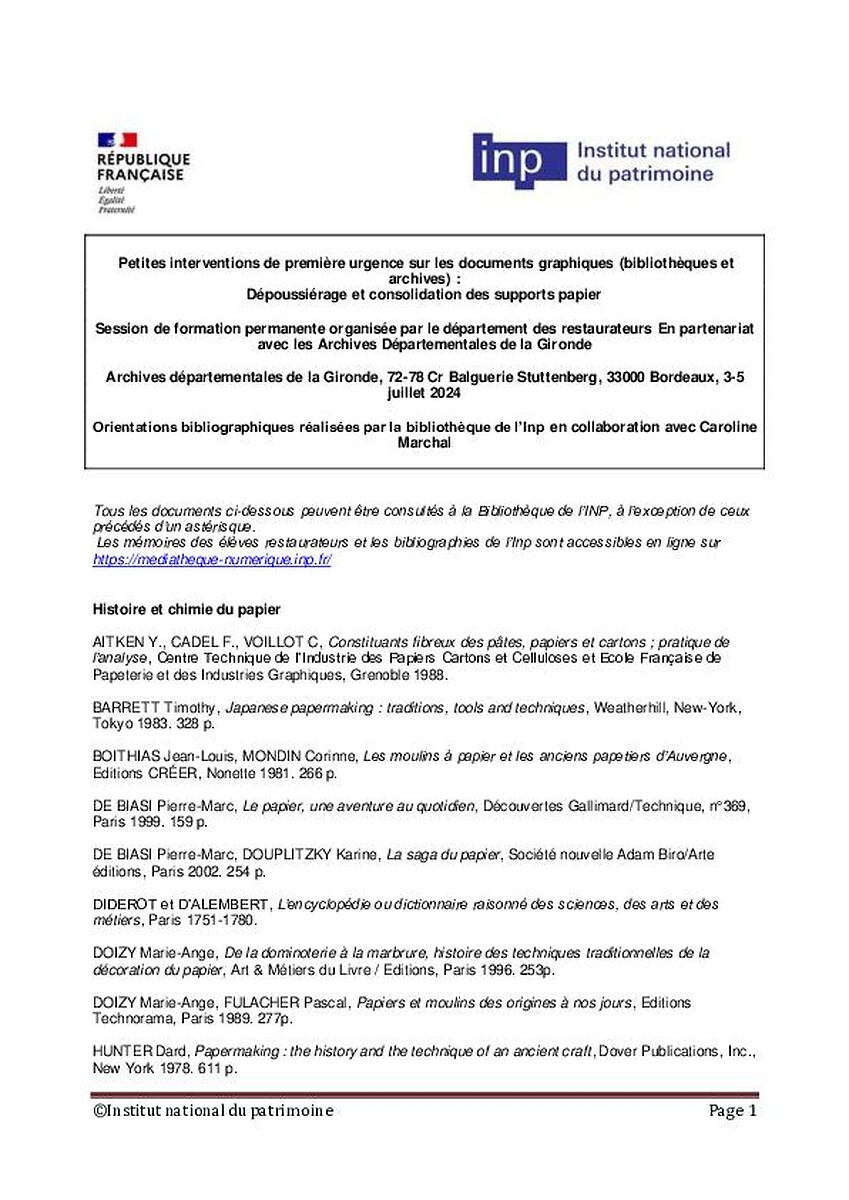Les évangiles de la Sainte-Chapelle
Collection
N° : 508
video/mp4
- 22,2 Mo
- 480x360
- sRGB
Description / Résumé
Entretiens de Marie-Pierre Laffitte, responsable des manuscrits latins, Bnf, Charlotte Denoël, BnF et Gilles Munck, restaurateur, BnF Les trésors du patrimoine écrit / Les documents de la Bibliothèque nationale de France - des Archives nationales à la loupe.
Partenariat entre l'Institut national du patrimoine et Connaissance des arts. L'Inp, la BnF et les Archives nationales organisent chaque année un cycle de conférences consacrés aux trésors du patrimoine écrit. Conservateurs, historiens de l'art, spécialistes des textes et restaurateurs partagent avec les étudiants, amateurs et curieux leur savoir et leur passion autour de manuscrits et de documents originaux, qui sont exceptionnellement sortis des réserves de la BnF et des magasins des Archives nationales.
Les Évangiles de la Sainte-Chapelle, qui comptent parmi les plus belles productions de l’art ottonien, ont été exécutés par le talentueux Maître du Registrum Gregorii à la demande de l’archevêque de Trèves Egbert vers 984. Celui-ci destinait probablement le manuscrit à Henri le Querelleur, dont il soutint les prétentions au trône impérial à la mort de Otton II, en 983, avant de se rallier finalement au parti de la princesse grecque Théophano et de son jeune fils, Otton III. A l’appui de cette hypothèse, les médaillons du feuillet 16 renferment les portraits des trois premiers empereurs ottoniens, Henri Ier, Otton Ier et Otton II, ainsi que de Henri le Querelleur, duc de Bavière. L’échec des visées impériales de Henri le Querelleur dut mettre un terme à l’exécution du manuscrit, dont certaines parties sont demeurées inachevées.
Destiné à un futur empereur, ce manuscrit de très grand luxe a été exécuté avec un soin particulier, depuis le texte entièrement transcrit à l’encre d’or, jusqu’aux cinq peintures en pleine page représentant le Christ en majesté et les quatre évangélistes, en passant par les tables des canons rehaussées d’arcades à l’antique ornées de motifs variés et de petites scènes de genre, les pages d’incipits décoratives insérées dans de riches encadrements, les initiales à rinceaux dorés et les incipits et explicits tracés en capitales dans des cartouches de couleur alternativement pourpre et verte. Caractéristique de l’art du Maître du Registrum Gregorii, cette remarquable décoration révèle un artiste aux références éclectiques, fin connaisseur des procédés picturaux et illusionnistes de l’Antiquité comme des oeuvres de l’époque carolingienne. La filiation avec les modèles carolingiens est particulièrement sensible dans la peinture initiale du Christ en majesté, dont les traits sont empruntés à l’école de Tours, et dans les portraits des évangélistes, dérivés de l’école palatine de Charlemagne. Mû par un idéal classique, le Maître du Registrum Gregorii se distingue par ses compositions savamment agencées, son dessin élégant au modelé à la fois souple et ferme et son sens étonnant de la plasticité du corps humain et de la spatialité.
Privé de destinataire à la suite de la défaite de Henri le Querelleur, le manuscrit fut finalement déposé à l’abbaye Saint-Willibrord d’Echternach, où ses peintures en pleine page servirent de modèle à de nombreux livres d’Évangiles produits dans cette abbaye à partir des années 1030. D’Echternach, ces Évangiles sont ensuite passés en France, probablement au XIIIe siècle, où ils ont appartenu à saint Louis, comme l’attestent les tranches peintes aux armes de France et de Castille. En 1379, ils ont été offerts par Charles V à la Sainte-Chapelle, dont les anciens inventaires mentionnent la reliure d’orfèvrerie commandée à cette occasion. Celle-ci se compose de deux ais exécutés à des dates différentes : daté du troisième quart du XIIIe siècle et remanié au siècle suivant, le premier (plat inférieur actuel) représente une Crucifixion en ronde-bosse provenant peut-être d’un autre objet et fixée sur une plaque d’or sertie de pierres précieuses ; le second (plat supérieur actuel) est une plaque d’or niellé au fond semé de fleurs de lys, sur laquelle saint Jean, entouré des symboles des quatre évangélistes et d’un ange, est figuré en train de transcrire son évangile. Réplique des peintures ottoniennes du manuscrit, cette plaque au style archaïsant a été exécutée en 1379, lors de l’entrée du manuscrit dans le trésor de la Sainte-Chapelle, ainsi que le rappelle l’inscription figurant dans le cartouche au-dessus de saint Jean.
Partenariat entre l'Institut national du patrimoine et Connaissance des arts. L'Inp, la BnF et les Archives nationales organisent chaque année un cycle de conférences consacrés aux trésors du patrimoine écrit. Conservateurs, historiens de l'art, spécialistes des textes et restaurateurs partagent avec les étudiants, amateurs et curieux leur savoir et leur passion autour de manuscrits et de documents originaux, qui sont exceptionnellement sortis des réserves de la BnF et des magasins des Archives nationales.
Les Évangiles de la Sainte-Chapelle, qui comptent parmi les plus belles productions de l’art ottonien, ont été exécutés par le talentueux Maître du Registrum Gregorii à la demande de l’archevêque de Trèves Egbert vers 984. Celui-ci destinait probablement le manuscrit à Henri le Querelleur, dont il soutint les prétentions au trône impérial à la mort de Otton II, en 983, avant de se rallier finalement au parti de la princesse grecque Théophano et de son jeune fils, Otton III. A l’appui de cette hypothèse, les médaillons du feuillet 16 renferment les portraits des trois premiers empereurs ottoniens, Henri Ier, Otton Ier et Otton II, ainsi que de Henri le Querelleur, duc de Bavière. L’échec des visées impériales de Henri le Querelleur dut mettre un terme à l’exécution du manuscrit, dont certaines parties sont demeurées inachevées.
Destiné à un futur empereur, ce manuscrit de très grand luxe a été exécuté avec un soin particulier, depuis le texte entièrement transcrit à l’encre d’or, jusqu’aux cinq peintures en pleine page représentant le Christ en majesté et les quatre évangélistes, en passant par les tables des canons rehaussées d’arcades à l’antique ornées de motifs variés et de petites scènes de genre, les pages d’incipits décoratives insérées dans de riches encadrements, les initiales à rinceaux dorés et les incipits et explicits tracés en capitales dans des cartouches de couleur alternativement pourpre et verte. Caractéristique de l’art du Maître du Registrum Gregorii, cette remarquable décoration révèle un artiste aux références éclectiques, fin connaisseur des procédés picturaux et illusionnistes de l’Antiquité comme des oeuvres de l’époque carolingienne. La filiation avec les modèles carolingiens est particulièrement sensible dans la peinture initiale du Christ en majesté, dont les traits sont empruntés à l’école de Tours, et dans les portraits des évangélistes, dérivés de l’école palatine de Charlemagne. Mû par un idéal classique, le Maître du Registrum Gregorii se distingue par ses compositions savamment agencées, son dessin élégant au modelé à la fois souple et ferme et son sens étonnant de la plasticité du corps humain et de la spatialité.
Privé de destinataire à la suite de la défaite de Henri le Querelleur, le manuscrit fut finalement déposé à l’abbaye Saint-Willibrord d’Echternach, où ses peintures en pleine page servirent de modèle à de nombreux livres d’Évangiles produits dans cette abbaye à partir des années 1030. D’Echternach, ces Évangiles sont ensuite passés en France, probablement au XIIIe siècle, où ils ont appartenu à saint Louis, comme l’attestent les tranches peintes aux armes de France et de Castille. En 1379, ils ont été offerts par Charles V à la Sainte-Chapelle, dont les anciens inventaires mentionnent la reliure d’orfèvrerie commandée à cette occasion. Celle-ci se compose de deux ais exécutés à des dates différentes : daté du troisième quart du XIIIe siècle et remanié au siècle suivant, le premier (plat inférieur actuel) représente une Crucifixion en ronde-bosse provenant peut-être d’un autre objet et fixée sur une plaque d’or sertie de pierres précieuses ; le second (plat supérieur actuel) est une plaque d’or niellé au fond semé de fleurs de lys, sur laquelle saint Jean, entouré des symboles des quatre évangélistes et d’un ange, est figuré en train de transcrire son évangile. Réplique des peintures ottoniennes du manuscrit, cette plaque au style archaïsant a été exécutée en 1379, lors de l’entrée du manuscrit dans le trésor de la Sainte-Chapelle, ainsi que le rappelle l’inscription figurant dans le cartouche au-dessus de saint Jean.
Auteur/artistes/intervenants
Type de document
Institution(s) prêteuse(s) / Institution(s) partenaire(s)
Service producteur INP
Producteur(s) externe(s)
Réalisateur
Date de captation
Mots-clés
Citer la ressource
Laffitte, Marie-Pierre ; Munck, Gilles, "Les évangiles de la Sainte-Chapelle", Médiathèque numérique de l'Inp, 19 novembre 2008 (consulté le 19 février 2026), https://mediatheque-numerique.inp.fr/rencontres-debats/tresors-patrimoine-ecrit/evangiles-sainte-chapelle
Type de licence
CC BY-NC
Conditions d'utilisation
L'institut national du patrimoine autorise l’exploitation de ce document à des fins non commerciales, ainsi que la création d’œuvres dérivées, à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale.
Crédit de l'image de couverture
Inp - Tous droits réservés